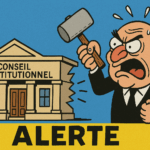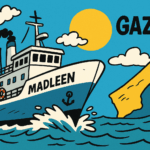Le droit international ? Oui, mais pas pour les copains.
Introduction:
Depuis le temps qu’on nous promettait « l’embrasement régional », fallait bien que ça pète quelque part. D’un côté Israël, son armée high-tech et son impunité certifiée ONU. De l’autre, l’Iran, présenté comme l’épouvantail nucléaire permanent, genre boss final du Moyen-Orient. Et au milieu, les États-Unis qui font mine d’être des arbitres alors qu’ils ont installé la table, choisi les joueurs, et fourni les armes.
Résultat : une guerre de basse intensité qui flambe à coups d’opérations “préventives”, d’assassinats ciblés, de bombardements “chirurgicaux”, et de communiqués calibrés pour les JT du soir.
Mais au-delà des frappes, des drones et des lignes rouges franchies ou pas, ce conflit expose une mécanique vieille comme l’impérialisme : on fait monter la tension, on désigne les méchants, on vend des armes, on pleure les victimes et on recommence.
Sauf que dans l’histoire, les salauds officiels ne sont pas toujours ceux qu’on croit, et les “forces démocratiques” ont souvent les mains très sales. Alors aujourd’hui, on retourne la carte, on gratte la surface, et on va voir ce que cette guerre dit du rapport entre Israël, l’Iran, et leur bienfaiteur américain, mais aussi de nous, de notre presse, de notre complaisance, de notre mémoire sélective.
Comprendre l’histoire de base
(ou pourquoi Israël et l’Iran se détestent cordialement depuis plus de 40 ans)
L’Iran avant et après 1979 : de l’allié d’Israël à son opposant
À une époque pas si lointaine, Israël et l’Iran s’échangeaient des infos, du pétrole, et même quelques câlins stratégiques dans l’ombre. C’était le bon vieux temps du Shah Mohammad Reza Pahlavi, le grand pote de l’Occident : pro-américain, anti-soviétique, bien coiffé et pas du tout élu. Autant dire, le profil parfait pour que Tel-Aviv et Téhéran s’adorent discrètement.
Puis, en 1979, l’Histoire a claqué la porte d’un grand coup de Coran. La Révolution islamique renverse le Shah et installe un régime théocratique chiite mené par l’ayatollah Khomeini. Adieu les cocktails diplomatiques, bonjour les slogans “Mort à Israël” en majuscule. Changement d’ambiance, changement d’alliés.
Mais il faut le rappeler : la révolution iranienne n’était pas d’abord un délire religieux. C’était une insurrection populaire contre une monarchie autoritaire, brutale, corrompue, et surtout complètement soumise aux intérêts américains. La SAVAK (police secrète du Shah) torturait à tour de bras, les inégalités explosaient, pendant que le régime achetait des armes dernier cri à Washington. Les mollahs ont pris le pouvoir, mais c’est la misère et l’humiliation qui ont allumé la mèche.
D’un coup, Israël devient non seulement l’ennemi idéologique, mais aussi le symbole de tout ce que l’Iran post-révolution veut combattre : l’Occident arrogant, l’impérialisme, la domination régionale. On passe donc d’un axe discret à une haine déclarée, exportable, durable — et très utile politiquement pour les deux camps.
Pourquoi l’Iran s’oppose à Israël
Officiellement ? Par principe. Parce qu’Israël est perçu comme un État colonial, illégitime, usurpateur.
Mais soyons clairs : derrière les discours anti-sionistes flamboyants, il y a une vraie stratégie géopolitique. Le régime iranien s’appuie sur une idéologie chiite révolutionnaire qui veut casser la domination sunnite et occidentaliste au Moyen-Orient. Et rien de tel que la cause palestinienne pour fédérer les foules.
C’est efficace : pendant que les régimes arabes normalisent un par un leurs relations avec Israël, l’Iran se place en leader du « front de résistance ».
Comprendre : le seul encore debout à hurler contre Tel-Aviv pendant que les autres signent des contrats avec Total.
Ce front, c’est un joli puzzle de groupes armés et de régimes amis :
👉 Hezbollah au Liban,
👉 le Hamas (en partie soutenu),
👉 le régime syrien d’Assad,
👉 et une présence grandissante en Irak et au Yémen.
Bref, l’Iran se donne le rôle de contre-pouvoir régional et d’alternative au bloc États-Unis/Israël/Golfe.
C’est pas propre, c’est pas net, mais ça existe.
Le rôle d’Israël dans la région
À la base, Israël est né isolé, encerclé par des pays hostiles, avec une mémoire brûlante de la Shoah et une obsession : la survie.
Résultat : une stratégie ultra-sécuritaire, une armée hypermoderne, et une diplomatie musclée qui vise à préempter toute menace, surtout si elle parle perse.
Avec le temps, Israël a trouvé un parrain bienveillant : les États-Unis. Argent, armes, soutien diplomatique… Tout y passe, y compris le véto automatique au Conseil de sécurité de l’ONU. Cerise sur le sabbat : le rapprochement progressif avec les régimes du Golfe (Arabie Saoudite en tête), tous très occupés à détester l’Iran.
Du coup, Israël se sent pousser des ailes — et des missiles. Sa doctrine ? Pas d’attaque frontale, mais des frappes ciblées, du sabotage nucléaire, des assassinats de scientifiques, et une surveillance permanente des positions iraniennes en Syrie et ailleurs.
C’est ce qu’on appelle la “dissuasion active”.
Traduction : “On ne commence pas la guerre… mais on fait tout pour qu’elle démarre quand même.”
Nucléaire iranien : mythe et réalité
(ou comment on fabrique des bombes imaginaires pour mieux faire exploser des traités réels)
Pourquoi l’Iran est soupçonné de vouloir la bombe
Tout a commencé par quelques “découvertes” dans le désert.
Au début des années 2000, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des services de renseignement occidentaux révèlent que l’Iran n’a pas été tout à fait transparent sur certaines installations nucléaires : Natanz, Arak, Fordo… On découvre que ça creuse, que ça enrichit, et que ça ne prévient pas toujours.
Immédiatement, la presse et les chancelleries occidentales passent en mode Hollywood : si c’est secret, c’est suspect. Et si c’est suspect, c’est forcément une bombe.
On oublie au passage que la non-déclaration d’un site ne signifie pas nécessairement l’intention militaire, surtout quand t’es dans une région où Israël a l’arme nucléaire mais ne l’admet jamais, et où tu t’es pris une guerre avec Saddam deux décennies plus tôt.
D’un côté donc, le récit occidental : l’Iran ment, il triche, il va faire sa bombe dans six mois (depuis vingt ans).
De l’autre, le récit iranien : on développe une technologie civile, on est membre du Traité de non-prolifération (TNP), et si on garde certaines infos, c’est peut-être parce que vous nous assassinez nos scientifiques depuis dix ans.
Le JCPOA (Accord nucléaire de 2015)
En 2015, miracle diplomatique : après des années de bras de fer, l’Iran et six grandes puissances (États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Russie) signent un accord historique : le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
L’idée est simple : l’Iran accepte de réduire drastiquement ses capacités nucléaires (enrichissement plafonné, centrifugeuses arrêtées, stocks réduits, réacteurs modifiés), en échange d’un allègement des sanctions économiques.
L’AIEA est chargée de contrôler tout ça au microscope : inspections renforcées, accès régulier aux sites, rapports publics.
Résultat : entre 2015 et 2018, l’Iran respecte l’accord à la lettre, et les inspections le confirment.
Mais comme souvent, quand la diplomatie fonctionne, c’est qu’elle va bientôt être sabordée.
Trump et la rupture unilatérale de l’accord (2018)
En 2018, Donald Trump sort le bazooka.
Sans aucune violation constatée par l’AIEA, il déchire l’accord unilatéralement, sous pression de Netanyahou.
Ses excuses ?
– L’accord est “trop mou” ;
– Il ne couvre pas les missiles balistiques ;
– Il ne dure “que” 15 ans ;
– Et puis l’Iran, c’est le Mal.
Côté conséquences :
➡️ retour des sanctions économiques les plus violentes ;
➡️ effondrement de la confiance entre l’Iran et l’Occident ;
➡️ reprise de l’enrichissement par Téhéran, en mode “à quoi bon jouer le jeu si on vous le sabote ?”.
Les Européens ? Ils râlent mollement, créent un machin sans dents appelé INSTEX pour faire des échanges sans dollars, et finissent par baisser les bras.
L’AIEA, elle, continue de dire que l’Iran ne fonce pas vers la bombe — mais comme tout le monde a repris sa propagande, personne n’écoute plus.
L’Iran a-t-il violé l’accord ?
Non.
Enfin, pas avant que les autres l’aient enterré.
Pendant plus d’un an après le retrait américain, l’Iran reste dans l’accord, en espérant un retour des signataires.
Ce n’est qu’à partir de 2019 qu’il commence à reprendre certaines activités d’enrichissement, graduellement, comme levier de pression.
Les rapports de l’AIEA jusqu’en 2025 indiquent :
✔️ Une reprise partielle et encadrée,
✔️ Pas de preuve de militarisation du programme,
✔️ Des stocks d’uranium plus élevés, oui,
✔️ Mais toujours très loin du seuil pour une arme opérationnelle.
Bref : pas de bombe, pas de programme secret actif, juste une logique de rétorsion dans un monde où le pays qui a respecté l’accord est celui qui en paie encore le prix.
C’est là que l’Iran a pigé un truc : plus on parle d’uranium, plus les caméras s’agitent, plus les Occidentaux paniquent, et plus il y a moyen de forcer la discussion. Le nucléaire devient un levier de survie économique. Quand les sanctions étranglent tout un pays, faire grimper les centrifugeuses devient une manière de dire : *Vous voulez qu’on arrête ? Parlez avec nous.*
Qui menace qui vraiment ?
(spoiler : ce n’est pas celui qu’on vous montre en boucle sur BFM)
L’Iran a-t-il déjà attaqué un autre pays ?
On va commencer par une question toute bête :
👉 L’Iran a-t-il déjà déclaré une guerre à qui que ce soit depuis 1979 ?
Réponse courte : non.
Réponse longue : non plus, mais ça ne l’a pas empêché d’être présenté comme la prochaine apocalypse ambulante tous les six mois depuis 2002.
Petit flashback : en 1980, c’est l’Irak de Saddam Hussein (alors soutenu par les États-Unis ET par la France, cocorico) qui attaque l’Iran. Huit ans de boucherie plus tard, l’Iran n’a pas pris Bagdad, pas annexé de territoires, et s’est contenté de survivre.
Depuis ? Pas une seule guerre déclenchée officiellement par l’Iran. Ce que Téhéran a développé, c’est une politique de guerre par procuration : soutien logistique, financier ou militaire à des groupes armés dans la région — le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, certaines milices chiites en Irak, et une relation plus tactique qu’idéologique avec le Hamas.
Est-ce propre ? Non. Est-ce illégal ? Parfois. Est-ce une stratégie de domination régionale ? En partie.
Mais ce n’est pas une politique d’expansion militaire directe comme on l’a vu avec, disons, les États-Unis, la Russie ou… Israël.
Israël et les frappes préventives
Ah, les fameuses frappes “préventives” — spécialité maison d’Israël depuis des décennies.
La doctrine a même un petit nom bien techno : le “MABAM”, ou “guerre entre les guerres”.
Traduction : “On vous bombarde un peu tout le temps pour éviter de devoir vous bombarder beaucoup plus tard.”
Concrètement, Israël a mené ces dernières années des centaines de frappes en Syrie, visant des convois d’armes, des milices pro-iraniennes, ou simplement des infrastructures jugées “menaçantes”.
Des opérations en Iran même (sabotages nucléaires, explosions “mystérieuses”, assassinats de scientifiques), des frappes à Gaza, au Liban, et une surveillance aérienne quasi constante sur tout ce qui bouge entre Beyrouth et Bagdad.
Ajoutez à ça un arsenal nucléaire réel, mais jamais reconnu officiellement — ce qui permet à Israël de ne pas signer le Traité de non-prolifération (TNP) tout en dénonçant l’Iran qui, lui, l’a signé.
Et tout ça, bien sûr, avec le silence complice des chancelleries occidentales, qui doivent confondre “prévention” et “provocation permanente”.
L’hypocrisie occidentale
C’est ici que le grand cirque moraliste devient franchement indécent.
👉 Deux pays. Deux politiques régionales musclées. Deux approches nucléaires.
Et pourtant : un seul est considéré comme une menace globale.
L’Iran, membre du TNP, sous surveillance de l’AIEA, sanctionné, isolé, diabolisé.
Israël, puissance nucléaire non déclarée, hors TNP, pratiquant la frappe préemptive régulière… intouchable.
Pourquoi ? Parce que les “bons” et les “méchants” sont désignés à l’avance, selon les intérêts stratégiques occidentaux. Et tant pis pour le droit international, la logique ou les faits.
Les États-Unis et l’Union européenne ont beau connaître les rapports de l’AIEA, ils continuent de parler de “menace iranienne”, comme si l’accumulation de centrifugeuses était plus dangereuse qu’un stock déjà prêt à l’emploi dans le désert du Néguev.
Et à force de répéter que “l’Iran est l’agresseur”, même quand c’est lui qu’on assassine, qu’on bombarde ou qu’on isole, on finit par rendre légitime une politique de punition préventive.
L’influence de la peur, de l’idéologie et des fantasmes
(ou comment on confond un mollah, un djihadiste, un imam et un fantasme de Zemmour)
Islam, chiisme, charia : fantasmes occidentaux
Depuis 1979, l’Iran est devenu l’écran de projection idéal pour toutes les peurs de l’Occident : islam politique, charia, haine d’Israël, cléricature menaçante, etc. Mais au lieu de faire dans le détail, on a tout jeté dans le même sac : chiites, salafistes, jihadistes, Al-Qaïda, Daech, mollahs, barbus = danger.
Or, petite mise au point pour les distraits :
➡️ Le chiisme iranien est un courant minoritaire, anti-wahhabite, théocratique certes, mais historiquement ennemi des mouvements jihadistes sunnites comme Al-Qaïda ou Daech.
➡️ L’Iran a même combattu ces groupes, militairement, sur plusieurs fronts.
➡️ Et pourtant, dans la plupart des narrations médiatico-politiques, c’est le même ennemi flou : “les islamistes”, qu’ils soient à Téhéran, à Raqqa ou à Molenbeek.
Pourquoi cette confusion est-elle entretenue ? Parce que ça nourrit une peur identitaire utile : l’Iran, dans l’imaginaire occidental, devient une menace civilisationnelle, une sorte de version nucléaire du “grand remplacement”.
Et dans ce délire, la réalité géopolitique pèse moins qu’un slogan bien flippant. Résultat : on a un pays qui n’a jamais bombardé Paris, jamais financé d’attentats sur le sol européen, ni exporté de wahhabisme… mais qu’on continue à classer au même niveau que des groupes terroristes.
Et pendant ce temps, on oublie que l’Iran, malgré sa théocratie, reste l’un des pays les plus instruits de la région. Les femmes représentent plus de 60% des étudiant·es à l’université. L’accès à la médecine, aux sciences, au droit, est bien plus ouvert qu’en Arabie Saoudite — pays ami des démocraties occidentales, mais où une femme ne peut pas prendre le bus sans autorisation.
Le discours politique occidental
Et pendant que l’opinion flotte entre fantasmes et confusion, les responsables politiques, eux, n’ont aucun scrupule à entretenir l’ambiguïté.
On entend des phrases comme :
– “Israël est notre bouclier contre la barbarie.”
– “Heureusement qu’ils font le sale boulot.”
– “Il faut des lignes rouges.”
Traduction ?
👉 Israël frappe, on ferme les yeux. L’Iran se défend ou réagit ? On crie à la montée des tensions.
👉 Et ça arrange tout le monde : ça justifie les ventes d’armes, flatte certains électorats, et évite à l’Europe de penser une vraie politique étrangère.
L’Union européenne, justement, oscille entre atlantisme mou et indignation diplomatique tiède. Elle ne pèse rien, ni à Washington, ni à Téhéran, ni à Tel-Aviv. Elle parle de paix, mais n’agit que pour sauver les contrats Airbus ou calmer un G7.
Bref, le récit dominant n’a pas besoin d’être vrai, il doit juste être utile. Et tant que la peur reste vendable, la nuance restera au placard.
Conséquences géopolitiques et humaines
(ou comment tout le monde perd, sauf les marchands d’armes)
Pour l’Iran
L’Iran, déjà affaibli, sort de cette guerre larvée avec trois boulets aux pieds :
👉 un effondrement économique, dû aux sanctions, à l’isolement bancaire, au sabotage intérieur ;
👉 une répression politique renforcée, parce qu’un régime assiégé ne s’ouvre jamais, il se durcit ;
👉 et une diplomatie internationale atomisée, car après avoir joué le jeu des accords (JCPOA), l’Iran a vu les règles changées en cours de partie.
Résultat : la population iranienne est prise en étau entre une élite autoritaire et un système international qui la punit collectivement pour des choix qu’elle ne contrôle pas.
Le message envoyé ?
“Vous avez voté pour la mauvaise révolution en 1979. Vous en paierez le prix jusqu’à nouvel ordre.”
Pour Israël
Sur le plan militaire, Israël n’a jamais été aussi solide :
– budget record,
– alliances stratégiques avec le Golfe,
– soutien inconditionnel des États-Unis.
Mais derrière ce mur de fer, une fissure morale s’élargit.
Sur le terrain diplomatique, Israël commence à sentir un isolement croissant :
– dans le Sud global (Afrique, Amérique latine, Asie), où la cause palestinienne et les critiques du double standard occidental gagnent du terrain ;
– auprès des jeunesses progressistes occidentales, qui ne gobent plus la ligne “on se défend” à chaque frappe préventive ;
– et même dans certaines instances internationales, où le discours sur la légitimité démocratique ne suffit plus à faire oublier les bulldozers, les check-points et les bombes sur Gaza.
Et au fond, Israël sait qu’il peut gagner toutes les batailles militaires, mais perdre peu à peu la guerre du récit. Et dans un monde médiatique, c’est pas rien.
Pour l’Occident
C’est peut-être le plus grand perdant, sans même s’en rendre compte.
À force de jouer les gendarmes à géométrie variable, l’Occident a sabordé ce qui lui restait de crédibilité morale.
Il prêche la démocratie, mais vend des armes à toutes les dictatures amies.
Il défend le droit international, mais le piétine dès qu’un allié le viole.
Résultat :
– le TNP (Traité de non-prolifération) est vidé de son sens : l’un a la bombe, l’autre non, mais c’est toujours le même qui est puni ;
– les pays non-alignés (Turquie, Inde, Afrique du Sud, Brésil) regardent ailleurs, construisent leurs propres alliances ;
– et les puissances révisionnistes (Russie, Chine, etc.) profitent de l’hypocrisie occidentale pour dire : “Regardez, ils ne respectent même pas leurs propres règles”.
Bref, à force de manipuler le droit, l’Occident a transformé l’ordre international en vaste théâtre d’intérêts déguisés. Et il ne faudra pas pleurer le jour où plus personne n’y croira.
Conclusion – Ce qu’on ne veut pas voir, et qu’il va pourtant falloir regarder en face
Comprendre ce triangle Iran–Israël–États-Unis, ce n’est pas prendre parti pour l’un contre l’autre. Ce n’est pas valider une théocratie rétrograde, ni nier le droit à la sécurité d’un peuple. C’est refuser de continuer à regarder le monde avec des œillères géopolitiques en carton recyclé par CNN.
Parce que ce conflit, en apparence lointain et complexe, est un miroir :
– de notre façon de fabriquer des ennemis utiles,
– de notre tolérance à géométrie variable,
– et de notre abandon progressif du droit au profit de la force.
Tant que l’Iran sera présenté comme une menace existentielle, même sans bombe,
tant qu’Israël pourra frapper qui il veut sans reddition de comptes,
tant que les États-Unis joueront aux parrains moraux avec un lance-roquettes dans le dos…
aucune paix n’est possible. Seulement des trêves entre deux emballements.
Et pendant qu’on parle d’Iran, ne tombons pas dans le piège du grand détournement. Gaza, elle, continue de tomber sous les bombes. Ce n’est pas parce qu’on explique le dossier iranien qu’on oublie le reste. Bien au contraire : c’est le même monde, les mêmes règles à deux vitesses. Le droit international ? Violé chaque jour. Par Israël. Par les États-Unis. Et ceux qui se défendent, même avec maladresse ou brutalité, sont immédiatement traités de menaces existentielles. Ça suffit.
Ce qu’il faut, c’est une lecture équilibrée, factuelle, fondée sur le droit, pas sur l’émotion, la propagande ou le calcul électoral.
C’est possible. Mais pour ça, il faut oser dézoomer. Oser dire que les bons ne sont pas toujours bons. Et que le silence, parfois, est une forme de complicité.
Il est temps de sortir de la logique d’exception et de domination, avant qu’elle ne devienne la norme pour tout le monde.